|

(Le texte suivant, en entier, est une copie du site web d' ALLOPHARM
rejoint avec "Copernic" car il semble impossible de relier ce
site au titre de cette page en créant un lien hypertexte,
comme je voulais le faire.)
"Depuis la nuit des temps, l’homme se soigne par les
plantes. Le sens de l'observation des anciens
ainsi que leur connaissance de la nature et leurs innombrables expériences leur ont permis de
constater les effets que pouvaient avoir les plantes sur l'organisme.
Ils en retiraient les principes actifs grâce à quelques opérations simples (séchage, broyage,
dilution, …) ou les utilisaient sous forme de tisanes, inhalations, cataplasmes ou onguents. Ces
remèdes, qualifiés de "simples", ont permis de soigner et de soulager l’humanité pendant des
millénaires.
Les sciences et les techniques ont petit à petit changé cette approche de l’art de soigner et de
guérir. Les progrès de la chimie, entre autres, ont permis de déterminer plus précisément les
principes actifs des plantes. Les premiers pas de la pharmacologie moderne ont été effectués en
copiant purement et simplement des molécules existant à l’état naturel dans le règne végétal.
Un des exemples les plus célèbres est celui des salicylates, dont l’acide le plus connu est
l’aspirine. Elle fut découverte par l’observation des effets d’une plante, le "Saule" puis d’une
autre, la "Gaulthérie", aussi appelée "Wintergreen", que les indiens d’Amérique du Nord utilisaient sous forme de
cataplasmes en cas de crampes, torticolis, enflures des articulations et des muscles. Le
Wintergreen fut préconisé dès le 19ième siècle dans les universités.
Étant donné les effets remarquables de ces plantes, la chimie débutante s'est penchée sur ces produits et a rapidement
trouvé la formule afin de la reconstituer en laboratoire: l’Aspirine était née. Il en est de même
pour beaucoup d’autres médicaments qui sont employés tous les jours dans tous les hôpitaux du
monde.
La meilleure illustration de l’importance du monde végétal comme ressource est le cri d’alarme
que lancent actuellement les scientifiques à propos de la destruction de la forêt amazonienne.
Chaque jour, selon eux, ce sont des plantes rares et inconnues aux molécules nouvelles qui
disparaissent et dont on n'a pas encore pu faire l’inventaire et découvrir le potentiel
médicamenteux.
A l'heure actuelle, le règne sans partage du médicament à base de molécules reconstituées
chimiquement a petit à petit montré ses limites. Bien entendu, on ne peut douter de l’efficacité de
ces médicaments. Par contre, de plus en plus souvent, on constate que cette efficacité
s’accompagne d’effets secondaires préoccupants.
Le cas des salicylates évoqué tout à l’heure à propos de l’aspirine est exemplaire. Il peut
provoquer des effets secondaires, connus sous le nom de "salicylisme", qui se traduisent par des
maux de tête, des nausées et, dans les cas les plus graves, des états comateux.
Aujourd’hui, de nombreux scientifiques, poussés peut-être par la demande croissante des
malades qui sont lassés de lire ou de subir les effets secondaires de certains médicaments
chimiques, se penchent sur les extraits de plantes et les étudient d’une autre manière que leurs
prédécesseurs.
Les extraits de plantes redeviennent des produits sérieux et utilisables. A ce titre, ils font l'objet
d’études scientifiques et rigoureuses. Ces possibilités sont offertes par la précision, la fiabilité et
les performances de l’appareillage disponibles dans les laboratoires modernes. L'analyse des
huiles essentielles a d'autant plus besoin de ces progrès technologiques qu'elles ne sont pas des
corps simples, mais bien des assemblages de molécules diverses ayant chacune leurs propriétés
particulières.
La méconnaissance de l’aromathérapie, ou son non-emploi, est à l’origine d’une extraordinaire
confusion dans les esprits. En ouvrant plusieurs ouvrages consacrés aux plantes médicinales, on
constate en définitive que chaque plante ou son huile essentielle est susceptible de traiter presque
tous les maux. L’origine de cette aberration est à rechercher tout d’abord dans les
nombreuses imprécisions botaniques, et, ensuite, dans la liste des emplois empiriques des plantes.
En effet, il faut savoir, par exemple, qu’il existe plusieurs centaines d’espèces
d’Eucalyptus, portant toutes le nom d’"Eucalyptus", mais dont les différentes huiles essentielles présentent des
compositions extrêmement diverses et dont les propriétés sont plus ou moins éloignées, voire
opposées. Utiliser, par exemple, une huile essentielle d’Eucalyptus pour traiter un état infectieux
bronchique, ne sera cohérent que si cette espèce contient en majorité des alcools aux propriétés
anti-infectieuses, soit l’Eucalyptus radiata ou globulus, entre autres. Dans le cas où serait utilisé
l’Eucalyptus citriodora (dont la composition est très différente), aucune amélioration notable ou
suffisamment rapide ne se présentera.
L’aromathérapie scientifique ouvre aux médecines naturelles une voie nouvelle vers la
reconnaissance de son intérêt, de sa valeur et de son utilité première pour la santé des hommes.
Les essences végétales sont élaborées par les plantes aromatiques au sein de cellules
sécrétrices.
Leur élaboration est tributaire du rayonnement solaire en l’absence duquel le rendement en
principes aromatiques et leur nature même se trouvent affectés. En sa présence et en fonction de
la prédominance de tel ou tel rayonnement, les types de composants pourront varier
considérablement au sein d’une même espèce.
Parmi les 800 000 espèces de plantes prospérant sur la planète, un nombre relativement
important synthétise des composants aromatiques. Cependant, certaines d’entre elles ne
possèdent pas suffisamment de cellules sécrétrices pour être considérées comme des plantes
dites "aromatiques". Certaines espèces sont manifestement plus orientées vers cette forme de
métabolisme et sécrètent en des proportions variable des HUILES ESSENTIELLES.
Les travaux approfondis en aromathérapie offrent indirectement une indication supplémentaire: la
nécessité d’utiliser des huiles essentielles et non des essences. Ces dernières, même déclarées
"naturelles", ne sont qu'une recomposition ou même, parfois, un pur assemblage artificiel. De
plus, elles sont irritantes pour les muqueuses et souvent agressives pour la peau.
Les huiles essentielles sont composées d'une série de molécules ayant chacune des caractéristiques
particulières. Les huiles essentielles doivent donc être contrôlées d’une manière stricte pour
obtenir une efficacité constante.
Les huiles essentielles et les essences d’expression sont des produits naturels qui, utilisés à des
fins préventives, curatives ou de bien-être favorisent une profonde revitalisation de l’organisme.
Mais, malheureusement, il n’est pas aisé de produire de véritables huiles essentielles de haute
qualité. Les difficultés tiennent avant tout à la rareté des plantes saines. En effet, la cueillette des
plantes sauvages demandent beaucoup de temps et une main-d'œuvre coûteuse, et les végétaux
de culture écologique sont, malgré les efforts des agrobiologistes et des organisations de
sauvegarde de la nature, encore trop peu abondants.
Seules seront d’authentiques produits de la nature les huiles essentielles pouvant se prévaloir
D'UNE TRIPLE GARANTIE: sur la plante, sur l’extraction et sur le produit final.
1) Le producteur doit être contrôlé puisque tout insecticide est susceptible de pénétrer dans
l'huile essentielle. De plus, une plante grandissant dans des lieux différents (altitude, latitude,
nature du sol, …) peut sécréter des essences très différentes. En outre, cette variabilité chimique
en fonction des biotopes est prédéterminée chromosomiquement. Elle peut même exister au gré
des saisons. Le nyctémère d'une plante est à considérer également, ainsi que le moment de la
journée choisi pour la récolte des plantes. Il est important de noter que l'activité enzymatique
d’une plante se poursuit durant son séchage ou sa fermentation (voulue).
2) La distillation demande, selon l’ancienne tradition, de grandes précautions. Les détartrants
chimiques devant bien entendu en être absolument bannis. L’honnêteté du Maître Distillateur doit
être complétée par une compétence scientifique et technique certaine. En effet, la haute
température et l’eau nuit toujours plus ou moins aux fragiles principes aromatiques. C’est
pourquoi la distillation est un procédé délicat exigeant de l’expérience et un tour de main spécial.
LA
DISTILLATION
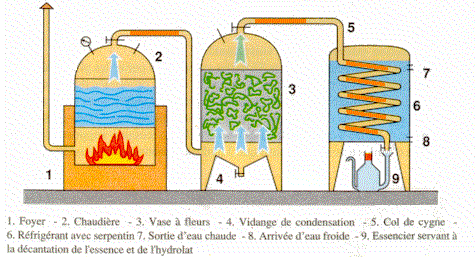
3) Les garanties sur la plante doivent être nombreuses:
a. Espèce botanique certifiée
Les lavandes donnent un exemple très explicite de la nécessité d’une précision botanique. En
effet, il existe plusieurs espèces, sous-espèces et variétés qui doivent être connues et séparées,
car leurs vertus sont très différentes :
La lavande vraie: la plus merveilleusement parfumée est la lavande officinale, variété
fragrante (Lavandula angustifolia ssp. angustifolia var. fragrans) comprenant une quinzaine
de races et de formes ; lavande à fleurs rondes ou longues, bleues, violette ou mauves,
voir blanches, à épis denses ou clairsemés, à tiges longues ou courtes, etc. Elle n’existe qu’à l’état sauvage sur les sols calcaires les plus secs de 700 à 1800 m d’altitude.
La lavande aspic (Lavandula latifolia): elle pousse à basse altitude (de 300 à 600 m).
La lavande stoechade (Lavandula stoechas): elle prospère dans les zones les plus
méridionales; elle présente une odeur moins suave, plus camphrée et entêtante.
Les lavandes hybrides (lavande vraie* lavande aspic - Lavandula* Burnatii): elles sont
communément appelées lavandins ; elles constituent la majorité des cultures actuelles en
raison de leur bonne productivité, malgré leur odeur moins fine (lavandin super) ou plus
camphrée (lavandin Abrial).
La "lavande blanche": ce n’est pas une vraie lavande (bien qu’il existe une lavande à fleurs
blanches), mais une autre plante (Sideritis) qui permettait, avant guerre, d’améliorer le
rendement lors de la distillation de la lavande vraie.
L’action physiologique des lavandes est presque toujours favorable mais varie en fonction de
l’espèce: la lavande vraie est apaisante et relaxante, la lavande aspic est tonique, la lavande
stoechade est mucolytique mais fortement neurotoxique. Connaissant cette réalité, quel thérapeute pourra à partir de maintenant, en toute conscience, prescrire : Huile essentielle de
lavande 5 gouttes sur un morceau de sucre 3 fois par jour, sans préciser de quelle lavande il veut
parler?
b. Race chimique définie
A l’intérieur de certaines espèces botaniques se différencient des races chimiques possédant
chacune un équipement enzymatique particulier, déterminé génétiquement et écologiquement
(conditions pédologiques, climatiques, d’altitude, etc.); la biosynthèse s’oriente vers la formation
préférentielle d’un constituant aromatique actif. Il est fondamental, donc, en ce qui concerne les huiles essentielles, de comprendre la notion de
"chémotypes" ou "races chimiques".
Concernant l’espèce "Thym vulgaire", il existe un certain nombre de races chimiques; le Thym,
quelque soit son biotope (milieu naturel), a les mêmes feuilles, les mêmes fleurs, les mêmes grains
de pollen, mais il synthétise des composant différents; tout se passe donc comme s’il s’agissait de
plantes différentes.
Par exemple, le Thym à thymol est un puissant anti-infectieux mais présente une forte
dermocausticité et une non moins nette hépatotoxicité en emploi sur une longe période . Au
contraire, le Thym vulgaire à thujanol, bien qu’également anti-infectieux, est non agressif et
stimule même les cellules hépatiques.
Cet non connaissance ou cet oubli des espèces ou des chémotypes a d’ailleurs été à l’origine
d’accidents sérieux ayant entraîné une limitation de la liberté de vente des huiles essentielles.
Le refus opposé par certains de la nécessité scientifique de connaître et d’utiliser les
chémotypes
en aromathérapie n’enlève rien à la certitude de leur existence mais, sans aucun doute, relègue
ceux qui le profèrent à une époque médicale dépassée.
Ces différences peuvent être extrêmement importantes et changer du tout au tout les propriétés
chimiques ou biologiques de l’huile essentielle; c’est la raison pour laquelle les
chémotypes
doivent être connus du praticien. Il est donc indispensable d’ajouter à la notion fondamentale
d’espèce botanique celle de race chimique ou chémotype. Seule la chimie moderne, avec ses
appareils sophistiqués, est capable de déterminer la teneur en "principes" d'une huile essentielle.
La chromatographie en phase gazeuse et la spectrophotométrie permettent d’établir la carte d’identité biochimique de chaque huile essentielle extraite de ces différents chémotypes et de détecter les molécules "saprophytes" causées par un "vice" lors de la production, de la récolte ou de la distillation.
Les différentes notions développées en aromatologie générale sont utiles pour élargir le champ conceptuel et renforcer les liens entre les maillons de la chaîne unissant la plante au patient.
Nous venons de montrer l’importance de la connaissance des familles, genres et espèces botaniques et la nécessité absolue de l'analyse de chaque lot. Celles-ci sont évidentes et obligatoires pour développer une aromathérapie digne de ce nom. L’ignorance de cette réalité peut être la source de nombreuses difficultés, voir de problèmes sérieux.
Prudence et connaissance: "Ce que tu ne connais pas, ne prétends pas le faire" écrivaient des sages au quatrième siècle av.
J.-C. Il en est de même en aromathérapie, la prudence est donc de rigueur. La connaissance
aussi."
Site
utile : (avis de deux pharmaciennes)
|